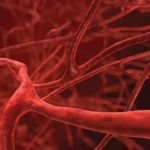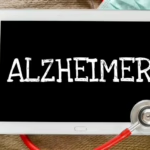Le Président Macron l’avait promise pour l’été 2023, une loi sur la fin de vie. Sa décision a été repoussée plusieurs fois avant d’être carrément ensevelie sous la dissolution de juin 2024. A l’occasion de la sortie de deux films sur le sujet, Emmanuèle Jeandet estime qu’il est temps de la remettre sous les projecteurs.
Par Emmanuèle Jeandet
Depuis des années nos concitoyens réclament une modification législative permettant d’accéder à une aide active à mourir dans des conditions précises.
Le Président de la République l’avait promis dès son premier mandat. Une Convention citoyenne a été réunie dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 2023 ; grâce à une écoute et des dialogues, dont l’authenticité et la qualité ont été unanimement salué, elle a permis de confirmer que 75 % des participants étaient favorables au suicide assisté et à l’euthanasie dans des conditions strictes permettant de s’assurer de l’expression de la volonté des patients.
Malgré cette consultation dont le résultat était clair, malgré de nombreuses prises de position allant dans le même sens par des parlementaires, des scientifiques, des philosophes, des professionnels …rejoignant ainsi les simples citoyens que nous sommes, le projet de loi n’émerge toujours pas. Certains aimeraient certainement son enterrement définitif, profitant ainsi des aléas de la vie politique, la dissolution de l’Assemblée nationale ayant ainsi mis fin à la procédure de débats et de vote d’un projet de loi. Il faut ajouter que l’actuel premier ministre est hostile au vote de ce texte et ne s’en cache pas.
Pourtant, jamais, il n’a été question de refuser à chacun le respect de sa conviction philosophique ou religieuse.
En démocratie, quand une large majorité de la population pense souhaitable de faire évoluer une loi, nos gouvernants auraient pourtant le devoir de mettre en œuvre cette volonté citoyenne exprimée au demeurant dans des conditions indiscutables….
Deux films, venant de sortir sur les écrans, remettent la question sur le tapis.
Deux œuvres, émanant de deux réalisateurs reconnus, au scénario très différent, mais traitant l’un comme l’autre de la fin de vie.
Voici, en peu de mots, le fil principal de chacun d’eux.
La chambre d’à côté de Pedro Almodovar, centre son propos sur une femme atteinte d’un cancer métastasé et dont la mort surviendra à un terme probablement bref. Elle décide de refuser les soins qui lui sont proposés pour prolonger une vie sans issue car sans guérison possible. Elle organise sa fin de vie et propose à l’une de ses amies de vivre avec elle les derniers jours qui la séparent de sa mort programmée. Elle lui dit que le jour où elle fermera la porte de sa chambre, c’est qu’elle se sera donnée la mort.
Le film, se déroule avec une grande distance pour ne jamais céder à la facilité de sombrer dans le mélodrame. Le réalisateur espagnol suit ces quelques jours, l’oreille tendue vers le dialogue entre ces deux femmes. Volonté de celle qui veut mourir, amitié et écoute de celle qui l’accompagne, dignité et respect chez les deux femmes, sont la marque de ce film, impressionnant et pudique.
Le dernier souffle de Costa Gavras est tiré d’un ouvrage co-écrit par Claude Grange, un médecin qui a créé et animé pendant vingt ans un service de soins palliatifs à l’hôpital public de Houdan (Yvelines) et par Régis Debray, philosophe et haut fonctionnaire. Sa sortie en salle a été accompagnée, notamment, par une interview croisée entre le réalisateur, le médecin et le philosophe (voir le Monde du 10 février 2025, interview menée par Béatrice Jerôme). Selon les mots de Costa-Gavras, son projet est de montrer qu’on peut « rendre l’inacceptable supportable » et de « remettre la question de la mort dans le débat public ».
Le film est un plaidoyer éloquent pour la mise en œuvre des soins palliatifs mais se refuse à évoquer le sujet de l’aide active à mourir pour, dit le réalisateur, ne pas peser sur le débat. Il déclare cependant, en fin de propos, que lui-même souhaite choisir sa fin de vie, au moment où, comme Jean-Luc Godard, il ne sera plus en mesure de continuer à créer des œuvres. Son long-métrage propose des tableaux successifs de personnes accueillies dans le service de soins palliatifs, en rendant visible leurs interrogations, leurs angoisses et celles de leurs proches ainsi que l’approche de leur mort. Il est émouvant, par moment bouleversant, et permet le croisement entre l’expression de l’humanité du médecin, le regard anxieux du philosophe et les derniers « souffles » de vie de ceux qui vont mourir.
Ces deux films permettront-ils de remettre sur le devant de la scène le sujet d’une loi fin de vie, incluant aide active à mourir et développement des soins palliatifs ?
Les aléas du monde auxquels nous assistons – consternés -, les chaos de la vie politique française, nous laisseront-ils le temps et la disponibilité pour voter une loi tant attendue, toujours reportée, et où la France, par comparaison avec nombre de ses voisins, européens notamment, apparaît si timorée et si ligotée par la force de quelques lobbies pourtant marginaux ?