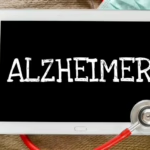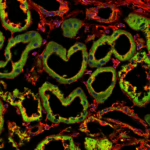Marguerite est bientôt nonagénaire. Lorsqu’elle évoque son enfance et sa vie de femme, marquées par le labeur, ses petits-enfants ont du mal à admettre sa résignation. Témoignage d’une femme paysanne née l’année des premiers congés payés.
Par Emmanuèle Jeandet
Marguerite a bientôt 89 ans. Elle a perdu son mari l’an dernier et vit à l’écart, aux marges d’une petite commune de campagne dans la grande banlieue de la Métropole de Rouen.
Les journées lui semblent longues et elle se sent souvent seule, même si la plupart de ses enfants et petits-enfants sont en lien avec elle. Ses deux filles en particulier s’occupent beaucoup d’elle et s’efforcent de lui éviter risques et soucis.
Elle revendique le choix de ne pas aller en EHPAD et de rester chez elle pour profiter de sa liberté (toute relative car elle se déplace peu et difficilement), en tout cas celle de choisir ses horaires pour se lever, se coucher, se laver, prendre ses repas, regarder ou non la télévision, faire des coloriages ou parcourir le journal que lui apporte son neveu et voisin, le samedi.
Enfance
Marguerite est la seconde d’une fratrie de treize enfants. Fille d’agriculteur, elle n’a connu dans son enfance que la vie à la campagne dans une exploitation d’élevage laitier. Dès leur plus jeune âge, elle et ses frères et sœurs ont participé aux travaux de la ferme – traire les vaches, à la main bien-sûr, nourrir tous les animaux. Il ne se passait pas un jour sans cette obligation, ce qui ne laissait pas de temps pour les devoirs scolaires. A 14 ans, les enfants ont été « placés » chez les fermiers des environs ; elle, comme tous les autres, a été « mise au travail » sans pouvoir prolonger sa scolarité. Ce qu’elle gagnait, elle en ignorait le montant, était intégralement versé à son père.
Elle qualifie aujourd’hui son enfance de « malheureuse », mais elle reconnaît que ce qualificatif ne lui traversait pas l’esprit quand elle était petite : les choses étaient ainsi et aucun autre modèle n’était connu qui aurait permis une comparaison et une évaluation avec des enfants mieux protégés et plus nantis.
Les souvenirs qui l’ont marquée sont imprégnés par la toute-puissance du père face à l’asservissement de la mère. Les enfants mangeaient sans parler, les bras croisés sur la poitrine dès qu’ils avaient avalé une bouchée ; ils ne pouvaient quasiment pas boire au cours du repas car ils ne disposaient que d’un unique verre d’eau qu’ils se passaient de l’un à l’autre. S’ils avaient soif, tant pis pour eux ! A la moindre incartade ou au moindre écart face aux règles imposées, le père sortait sa ceinture et les frappait du côté de la boucle. Marguerite dormait dans une chambre avec six autres frères et sœurs ; au moindre bruit, ils étaient traînés dans la chambre des parents et devaient rester agenouillés au pied du lit, toute la nuit.
L’autorité paternelle n’était jamais remise en cause, aucune critique ne s’exprimait, la mère se contentant de les prévenir lorsque le père arrivait pour tenter de leur éviter des châtiments imprévus. « De nos jours, reconnaît Marguerite, notre père serait condamné pour mauvais traitements ! »
Lorsqu’elle évoque le destin de sa mère, elle se demande comment cette dernière a pu supporter une telle vie sans se rebeller. Treize enfants à la suite, évidemment sans consentement, fruits de viol pense-t-elle aujourd’hui… A leur entretien, s’ajoutait le travail à la ferme et à la maison (trois journées par semaine étaient consacrées au linge – lessive, tricotage, ravaudage, couture). Marguerite se souvient que sa mère avait toujours le petit dernier dans les bras.
Les quatre derniers de la fratrie sont nés alors que Marguerite était déjà mariée. « Eux ont eu la chance de poursuivre leur scolarité quelques années de plus que leurs aînés et de pouvoir ainsi ouvrir d’autres horizons professionnels que les travaux ouvriers dans une exploitation agricole ».
Femme adulte
Marguerite, elle-même, n’a pas échappé à ce destin tout tracé. Mariée à un agriculteur, qu’elle a aimé – elle et Robert ont formé un couple très uni -, elle a intégralement partagé avec lui les tâches quotidiennes de la ferme, assurant chaque jour la traite des vaches comme durant son enfance ! Son époux était un homme courageux et bienveillant, mais il ne lui serait pas venu à l’idée que la vie d’une femme puisse être différente et pas uniquement consacrée à œuvrer pour la ferme et la maison, et à élever leurs trois enfants. (Trois et pas treize, nette différence où se mesurent le saut de génération et l’irruption du monde extérieur dans l’univers rural). N’empêche, la vie quotidienne restait rude : à chaque grossesse, quasiment jusqu’au jour de l’accouchement, Marguerite poursuivait ses tâches et assurait les travaux de la ferme. Le jour où la charrette de foin s’est renversée sur elle, elle s’est relevée et a repris le travail engagé. Pas d’accident professionnel ou de congé pour grossesse dans ce monde rural, où le travail des femmes n’était jamais compté comme du travail mais comme un engagement évident et bénévole, jamais remis en cause !
Aujourd’hui quand Marguerite raconte à ses petits-enfants la vie de sa jeunesse ou celle de sa maman, c’est l’incompréhension qui surgit : « comment ta maman pouvait accepter tout cela ? », « pourquoi vous, les enfants, vous ne disiez rien, vous ne critiquiez rien ? »
Oui, difficile à comprendre et à admettre…cet univers rural et patriarcal coupé du reste de l’évolution de la société, ce pouvoir monarchique du père devant lequel chacun devait céder. « Tout cela a bien changé », se réjouit Marguerite qui adore ses petits-enfants et passe des heures à contempler leurs photos qui tournent sur sa petite tablette. « Mais, ajoute-t-elle lucide, la misère existe encore dans le monde, même tout près de nous, et des femmes et des enfants malheureux, aussi ».