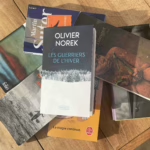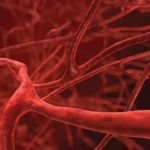L’école laïque et gratuite pour tous les enfants est le fruit d’une conquête. Jusqu’à Jules Ferry en 1882, seuls ceux issus des milieux favorisés avaient droit à de l’instruction. Et si on se souvenait que l’école est une chance ?
Par Françoise S.
La dernière rentrée des classes a éveillé en moi quelques réflexions.
Tout d’abord, l’envie de remercier Jules Ferry (1832-1893), ministre de l’Instruction Publique sous la Troisième République, qui, en 1882, a rendu l’enseignement laïque gratuit obligatoire dès l’âge de 6 ans et jusqu’à 13 ans. (Aujourd’hui, les enfants sont soumis à l’obligation d’instruction entre 3 et 16 ans).
Comme quoi France Gall a chanté à tort que c’est Charlemagne qui a inventé l’école !
Quelle libération l’obligation d’aller à l’école a été pour les enfants…
Car au 19ème siècle en France, durant l’industrialisation du pays, le travail des mineurs était courant. En 1840 par exemple, 150.000 enfants étaient employés par l’industrie textile, la métallurgie, les mines… Ils représentaient une main d’œuvre intéressante. Leur petite taille leur permettait de se glisser sous d’énormes métiers à tisser, de pousser des wagonnets dans les mines de charbon, de surveiller le fonctionnement des machines.
Payés trois fois moins que les adultes pour le même temps de travail – jusqu’à 18 heures par jour dès l’âge de 5 ans -, ils étaient en outre dociles. Leurs parents, issus des classes populaires, ayant souvent de nombreux enfants à charge, avaient besoin de leur salaire pour vivre.
Dans son poème Melancholia écrit en 1838 et publié dans le recueil les Contemplations, Victor Hugo évoque ces enfants travailleurs : « Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ils vont de l’aube au soir dans la même prison faire éternellement le même mouvement ».
Le médecin Louis René Villermé, qui a enquêté sur leur sort, les a décrits comme « de minuscules créatures hébétées réduites à l’état de machine ».
Leurs conditions de travail ont heureusement peu à peu évolué.
En 1841, une première loi a interdit le travail des enfants de moins de 8 ans.
Et réduit le temps de travail pour les autres : 8 heures au lieu de 12 heures.
En 1874, une loi a interdit le travail de nuit et définit un âge minimum pour travailler : 12 ans.
Aujourd’hui, certains enfants n’ont pas envie d’aller à l’école et préfèrent jouer avec leur smartphone et leurs jeux vidéo. Qu’ils se souviennent de leurs ancêtres qui auraient préféré être assis sur un banc devant le tableau noir plutôt que vivre « le siècle noir des enfants ». Et avant de céder aux sirènes de l’argent facile, qu’ils se rappellent que l’exploitation des mineurs n’est pas le propre de la Révolution industrielle. De nos jours, une nouvelle forme d’exploitation de mineurs existe et se répand dans les milieux populaires.
De jeunes adolescents entre 12 et 16 ans sont recrutés par des trafiquants de drogue sur les réseaux sociaux pour devenir des guetteurs, moyennant de l’argent. Pour 50 € à 150 € par jour, ils renoncent à leur scolarité pour guetter l’arrivée éventuelle de forces de l’ordre sur les lieux de vente. S’ils sont assidus, ils pourront évoluer et devenir rabatteurs, en informant les clients des lieux de vente pour 120 € par jour. Vers 25 ans, ils pourront même devenir livreurs ou dealers pour environ 300 € par jour. « C’est mieux payé que le Smic » se réjouissent certains d’entre eux.
Pourtant, il n’y a pas de quoi se réjouir.
Ces enfants n’auront ni étudié ni appris un métier. Ils connaitront certainement la prison. Ils pourront être séquestrés, battus et même tués. Car la guerre des gangs n’est pas un concept. L’actualité de ces derniers mois est pleine de règlements de compte entre gangs, ayant impliqué des mineurs attirés par le gain d’argent pour aller tuer un membre d’une bande rivale à l’autre bout de la France. En 2023, 47 mineurs ont été tués ou blessés en France.
Il devient urgent de protéger les enfants. Et de les ramener sur le chemin de l’école.