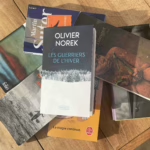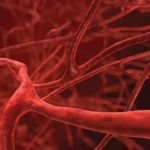Pas facile d’élever un enfant. Chaque parent en fait l’expérience, se trouvant à la fois confronté à l’impétuosité de son petit et aux conseils éducatifs qui jaillissent de partout. L’orientation actuelle est sous le signe de la bienveillance centrée sur le bien-être de l’enfant. A tort ou à raison, ainsi que le décrypte Claudie.
Par Claudie Perrot.
Parmi les courants de pensée proposés aux parents dans leurs questionnements éducatifs, on parle beaucoup d’éducation positive et bienveillante centrée sur le bien-être et le bonheur de l’enfant. Quel parent ne désire pas cela pour son enfant ? Certains psychothérapeutes émettent cependant des critiques par rapport à ce courant pédagogique qui a vu le jour au début des années 2000 aux Etats-Unis. C’est un chercheur américain en psychologie, Martin Seligman, qui en a élaboré le concept, en ne se concentrant pas seulement sur les troubles et les pathologies du psychisme humain mais en s’intéressant à ce qui peut l’aider et le renforcer. Autrement dit, il a cherché à comprendre ce qui rend l’être humain et heureux et épanoui. Ses conclusions, mettant en valeur la bienveillance, ont rapidement touché le domaine de l’éducation aux Etats-Unis, avant de débarquer en France dans les années 2010.
La psychothérapeute Isabelle Filliozat et la pédiatre Catherine Guéguen sont devenues les deux principales figures de proue de cette pratique éducative.
BA ba de l’éducation positive
L’éducation positive se définit comme un accompagnement basé sur la non- violence, l’écoute, la communication et le respect des besoins de l’enfant. Également appelée parentalité bienveillante, elle s’appuie sur des principes de soutien, de confiance et de discipline positive.
La plupart des psychothérapeutes sont d’accord avec cette définition puisqu’elle se situe dans l’intérêt de l’enfant. Rien de nouveau sous le soleil pourtant : c’est exactement ce que la psychologie inspirée par la psychanalyse ne cesse de soutenir depuis 100 ans !
En 2016, le Conseil de l’Europe en a donné la définition suivante : « L’éducation positive, c’est un comportement qui vise à élever l’enfant, à le responsabiliser, qui est non violent et qui lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son développement ».
Cependant, cette pédagogie a ses détracteurs. Selon eux, il ne faudrait pas mélanger besoin d’amour avec besoin de limites éducatives. Il est vrai que l’éducation à la frustration est primordiale dans la construction de l’enfant et, en cela, la pédagogie bienveillante peut être jugée trop laxiste. Caroline Goldman, docteur en psychopathologie, a d’ailleurs déclaré à ce sujet : « Ce n’est pas l’éducation positive qui est dangereuse mais l’éducation excessivement positive, c’est à dire sans interdits et sans éducation à la frustration ». Elle a raison : un enfant élevé sans limites peut en effet développer des comportements impulsifs et des difficultés dans ses relations avec autrui.
Poser des limites de façon ferme et bienveillante devrait commencer dès l’âge du quatre pattes, vers 8-9 mois, quand l’enfant cavale partout sans conscience des dangers qui l’entourent. Édicter des règles à cette étape lui apportera des repères et le rassurera.
Apprendre à gérer la frustration est également essentiel au développement d’un enfant. Vers l’âge de 2-3 ans, l’expérience de la frustration parce qu’un frère utilise le jouet convoité ou parce qu’un adulte ne répond pas immédiatement à une demande, permet à l’enfant de comprendre que l’autre a des envies et des droits. Ainsi, petit à petit, il va intégrer les notions de partage et d’autonomie.
En réponse à ceux qui ne jurent pas que sur l’éducation positive, Isabelle Filliozat a déclaré dans une conférence en 2019 « qu’il ne faut pas croire ceux qui préconisent de mettre des limites aux enfants, car cela éteint leur joie. Si le parent met une limite, son propre système de stress est activé et il enclenche chez l’enfant le même système de stress ».
Pour illustrer ce propos, voici deux exemples de pédagogie positive. Au supermarché, Zoé hurle et se roule par terre parce que sa maman refuse de lui acheter le paquet de bonbons qu’elle désire. Sa maman s’approche d’elle, capte son regard, et lui explique calmement : « je sais que tu es triste mais des bonbons il y en a déjà beaucoup à la maison ».
Autre exemple : À la crèche, Édouard 2 ans mord le bras d’Antoine qui pleure. La professionnelle, témoin de la scène dit à Édouard : « tu as mordu Antoine et il a très mal. Puisque tu aimes mordre, je vais te donner une pomme que tu pourras croquer ».
L’éducation positive soulève aussi des défis quotidiens pour les parents. Le manque de temps, la fatigue accumulée au cours d’une journée de travail rendent parfois difficiles l’application des principes bienveillants et génèrent un sentiment de culpabilité ainsi que la peur de ne pas être un bon parent. Rappelons-le, les parents ont le droit d’être fatigués, de mal faire, mais l’essentiel est de reconnaître ses faiblesses et de tendre vers le mieux, en expliquant et en recourant, si nécessaire, à des punitions non violentes comme faire réparer les dommages causés ou imposer une courte mise à l’écart temporaire.
Souvent présentée comme une révolution bienveillante dans la manière d’élever les enfants, l’éducation positive s’inscrit pourtant dans un mouvement plus large : celui de la « tyrannie du bonheur ». Derrière ses intentions louables — favoriser l’écoute, bannir la punition, valoriser l’émotion —, elle rejoint le vaste marché du développement personnel. Ce modèle, qui promet des enfants épanouis et des parents sereins, s’est transformé en véritable business. Livres, formations, conférences, coachings parentaux… la quête du parent parfait est devenue une marchandise parmi d’autres, portée par des « experts » pas toujours qualifiés.
Comme le souligne la sociologue Eva Illouz dans Happycratie, cette injonction permanente au bonheur produit paradoxalement beaucoup de culpabilité. Les parents se sentent fautifs s’ils élèvent la voix, s’ils n’appliquent pas à la lettre les recettes de la bienveillance. Pourtant, la plupart cherchent simplement à faire de leur mieux, en combinant différentes approches selon leurs valeurs et leurs enfants. Il n’y a pas de parents parfaits et une méthode d’éducation meilleure que les autres. Chaque parent fait comme il souhaite et comme il peut. Il n’y a rien de magique !