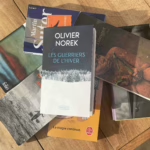L’école est finie…pour les élèves. Mais dans les faits, on espère que non. Si l’Éducation Nationale connaît des heures difficiles – violences scolaires, classes surchargées, enseignants débordés – , elle n’a pas dit son dernier mot. En tout cas, les aînés l’espèrent.
Revue de presse de la Maison des Aînés de Rouen.
Étaient présents : Christian, Marie-Claude, Marie-Laure, Serge,
Serge : Comment sanctuariser l’école et la préserver des violences qui nous entourent ? C’est un enjeu important. On ne peut pas accepter que des élèves pénètrent dans un établissement scolaire avec une arme blanche. On a vu les drames que cela pouvait provoquer.
Marie-Claude : Mettre en place des réglementations pour protéger l’école semble évident mais les mesures efficaces ne sont pas si simples à inventer ni à mettre en œuvre. On peut difficilement contrôler tous les élèves. Il faut surtout s’interroger sur le système éducatif dans son ensemble et sur ses liens avec la société. Pour commencer, les parents devraient être les premiers défenseurs de l’école ; comment conçoivent-ils son rôle eux qui ont aussi été des élèves ?
Marie-Laure : Bien souvent, les critiques exprimées par les familles reposent sur des constats qui ne correspondent pas à la réalité. On parle, par exemple, du nombre d’élèves dans les classes et, effectivement, il est très difficile pour un professeur de s’occuper de chaque enfant en fonction de son profil et de ses problèmes spécifiques dans des classes surchargées ; je ne pense pas, néanmoins, que le problème du nombre soit la première cause de la dégradation de la qualité de l’enseignement. J’ai été à l’école à Paris et nous étions très nombreux en cours mais cela ne nous empêchait pas d’être concentrés et attentifs.
S’il y a plus de difficultés au sein des écoles, je pense que c’est dû, en premier lieu, à une absence de limites. On veut laisser les enfants s’exprimer – et c’est très bien – mais on n’a pas mis de cadre à cette expression et les moyens nécessaires n’ont jamais été attribués. Cela rend l’enseignement plus compliqué, les élèves sont davantage dispersés et les enseignants doivent enseigner leur matière tout en prenant en compte un environnement moins lisible. Ils sont seuls pour tout effectuer ; cela peut expliquer le sentiment d’abandon qu’ils éprouvent.
Dans ce contexte, la relation entre les élèves et l’enseignant est primordiale mais au-delà de celle-ci, les enfants doivent avant tout accepter le principe même de l’enseignement. Aller à l’école est une chance dont ils n’ont pas vraiment conscience. Pourquoi va-t-on à l’école ? Quelle perspective offre-t-elle ?
Marie-Claude : L’enseignement étant obligatoire, les parents le considèrent comme un dû et les jeunes comme une contrainte, ils en oublient que c’est le meilleur moyen pour progresser et préparer leur avenir. Partout dans le monde, ce sont les enfants qui n’ont pas accès à l’instruction qui finissent par travailler dans les pires conditions. Prétendre le contraire est un leurre.
Serge : Tout le monde ne perçoit pas que le métier d’enseignant et les méthodes pédagogiques ont évolué. Cela a modifié le lien entre professeurs et élèves. Autrefois, les enseignants s’adressaient à leurs étudiants de manière plus rigide, parfois trop, mais très cadrée.
Christian : La discipline est une notion qui a beaucoup changé : du temps du Général de Gaulle, tout fonctionnait à la baguette, ensuite, avec mai 68, un vent de liberté a soufflé. Chaque époque porte une vérité différente. Aujourd’hui, les enfants ont davantage besoin de normes, c’est rassurant une norme, mais ils ont aussi besoin d’espace pour s’exprimer.
Beaucoup de personnes ont la nostalgie d’une époque où l’école pouvait imposer sa discipline sans aucune remise en cause. Pour autant, je ne regrette pas l’époque où les enfants subissaient des sévices comme à Bétharram ; je ne regrette pas le temps où ils devaient obéir sans discuter ; je ne regrette pas les coups de règles qu’ils prenaient sur les doigts. (Les miens s’en souviennent encore). La liberté d’expression est une chance qui permet de développer son intelligence.
Serge : Un cadre trop flou n’est pas forcément ce qu’il y a de mieux pour forger une intelligence. L’absences de repères ne permet pas d’aller bien loin. Mais évidemment, cela ne doit pas s’entendre de manière trop stricte.
Marie-Laure : Il est préférable de laisser les enfants vivre leurs propres expériences et de ne pas les décourager quand il se trompent. Il faut prendre le temps de leur expliquer et de les amener à comprendre.
Marie-Claude : C’est dans le temps long que l’apprentissage trouve toute sa valeur et qu’il suscite le désir de savoir. J’ai enseigné trois ans en Algérie après l’indépendance, les élèves étaient avides d’apprendre. Le soir, ils révisaient leurs leçons sous les réverbères quand ils n’avaient plus l’électricité chez eux.
Concernant l’équilibre entre la liberté d’expression et l’autorité, cela me fait penser à l’équilibre entre le masculin et le féminin. Il y a peu d’hommes à l’école, il peut exister un manque à ce niveau-là d’autant plus que l’autorité des femmes est plus facilement remise en cause ; pour être respectées, les femmes doivent faire preuve de davantage de compétence même devant les élèves.
Marie-Laure : D’un côté, les femmes enseignantes sont moins respectées, d’un autre côté, les filles sont moins encouragées dans leurs études ! En guise d’orientation, on envoie plus facilement les filles en difficultés dans les filières donnant accès à des métiers prétendument féminins, esthéticienne par exemple. C’est trop facile.
Trop souvent, on propose aux enfants, filles ou garçons, de faire des études en fonction d’un a priori de genre ou d’origine, sans tenir compte de leurs envies et sans chercher à mettre en valeur leur potentiel. Ce serait bien que les enseignants prennent le temps de mieux comprendre leurs élèves et notamment ce qu’ils vivent chez eux. Un divorce, des problèmes financiers dans la famille ou de la violence intrafamiliale peuvent empêcher un enfant de suivre en cours.
Christian : Les difficultés que vit l’école actuellement sont aussi dues au manque de formation des professeurs. Comment ces derniers peuvent-ils mettre en place une bonne pédagogie sans avoir acquis les fondements de leur métier ?Marie-Laure : Effectivement, si les enseignants éprouvent des difficultés, cela est aussi dû au manque de valorisation du métier. D’ailleurs de moins en moins de jeunes sont attirés par cette profession.